J’ai rêvé que j’étais un trou noir
par Bernard Dugué
mardi 27 juillet 2010
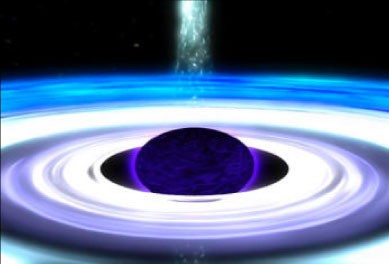
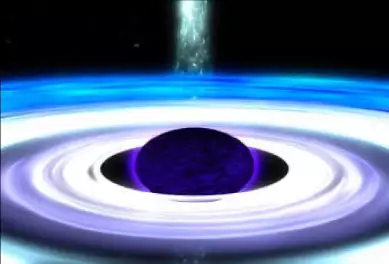
Même si la science ne veut pas connaître la nature, on trouve encore des savants pour s’interroger sur les choses et notamment, les choses physiques, matière, cosmos, particule, univers. Le vivant et le cerveau font aussi l’objet d’attentions savantes soutenues. Malgré le silence assourdissant des médias, il se pourrait bien qu’une révolution soit en marche, une révolution dans la vision, la conception, la connaissance des choses naturelles et de l’humain. Bref, un changement de paradigme tenant à la fois des avancées scientifiques et d’une démarche philosophique visant à connaître les « choses de l’humain et de l’univers », à l’instar des Plotin, Platon, Confucius et autres sages de l’Antiquité, comme le furent les brahmanes védiques. Nul n’entre dans le temple de la connaissance sans désir, aurait dit saint Augustin, théoricien des trois désirs humains parmi lesquels la libido sciendi occupe la place la plus noble.
Comment parvient-on vers cette nouvelle connaissance ? Parfois, cela arrive de manière fortuite, en découvrant quelques connivences secrètes entre des formalismes, ou alors en détectant des faits auparavant inconnus, ou enfin, voie royale s’il en est, en questionnant le réel et ses représentations, en se demandant, pourquoi et comment ça fonctionne, étant entendu que les réponses fournies dans les livres savants ne sont pas jugées satisfaisantes. Le sage philosophe du 21ème siècle doit faire sienne la chanson des Stones, I can’t get no… étant entendu que la satisfaction doit concerner non pas les plaisirs corporels mais la joie de connaître les secrets de l’univers. Mais il sera inspiré de mettre dans son lecteur CD In search of space de Hawkwind.
Quelque part vers 1995, il s’est produit deux événements scientifiques importants. Rappelons que la physique mathématique a été à l’origine de la révolution scientifique avec Galilée et Newton. Au milieu du 20ème siècle, une analogie entre l’entropie et l’information a été décelée, ce qui a constitué une petite révolution. Qui précède la grande révolution initiée par Hawking. Il existe une analogie plus profonde entre la thermodynamique et la mécanique quantique du trou noir et ce, au niveau des trois principes (Hawking, Penrose, La nature de l’espace et du temps, Gallimard, p. 62). Ted Jacobson enrichit alors la mécanique du trou noir avec le principe holographique et signe en 1995 un article retentissant, tout comme celui d’Erik Verlinde qui vient de publier un article controversé dans lequel il pousse à ses extrémités la voie ouverte par Jacobson. La gravitation aurait disparu du cercle fermé des forces fondamentales au profit d’une « force entropique ». On comprend l’agitation qui règne dans le milieu des physiciens qui restent perplexes, non sans supposer une porte ouverte enfoncée car si on lit les propos de Penrose, eh bien le statut spécial de la gravitation est connu depuis pas mal de temps. Mais c’est dans le cercle des philosophes de la nature que cette découverte devrait susciter un intérêt au plus haut niveau car la conception de l’univers risque de basculer. Mieux encore, cette nouvelle physique pourrait avoir des prolongements dans le champ de la biologie et des « sciences de la conscience ». Rappelons que le trou noir est cet objet théorique construit au point de rencontre des trois branches de la physique, autrement dit, là où toutes les qualités de la matière se conjuguent. Comme du reste au niveau de la conscience, qui elle, n’est pas un objet théorique mais le mode de perception le plus élaboré présent chez une espèce, l’humain.
Sans doute, il n’est pas question de conscience mais les neurosciences peuvent se prévaloir d’une intéressante découverte, celle des neurones miroirs. Dans le courant des années 1990, Giacomo Rizzolatti a mis en évidence l’activité de neurones moteurs correspondant à une action déterminée mais qui ne se produit pas. En fait, le singe ne fait qu’observer un de ses congénères exécutant cette action. Publiée en 1996, cette découverte est considérée comme majeure, expliquant notamment la production des relations sociales, les phénomènes mimétique, l’empathie mais aussi les facultés de perception artistique. Le philosophe ajoute juste un détail. Le thème du miroir est employé, dans un usage métaphorique ou allégorique, par Platon, afin d’expliquer le processus du connais-toi. C’est juste une précision évoquant une coïncidence ou alors une connivence dont l’importance est fondamentale pour comprendre la connaissance (par le miroir).
1996, c’est aussi l’année où je soutenais ma thèse de philosophie intitulée Procès et Miroir. Texte que je situe comme très important, voire même crucial, dans le champ de la métaphysique. Pour diverses raisons propres au fonctionnement de l’université, cette thèse n’a eu aucune incidence parmi les professeurs alors que son impact aurait du être supérieur à celui de Etre et Temps de Heidegger. On peut même considérer que si le Procès renvoie au Temps et le Miroir à l’Etre, alors nous avons peut-être la clé du questionnement sur lequel Heidegger buta en son temps. Wait and see, les philosophes finiront bien par se (r)éveiller. Cette étude dévoile une structure-en-miroir de la « matérialité » (explicitée en interprétant la mécanique quantique dans le septième chapitre de l’Expressionnisme, livre ayant comme objectif de situer et de présenter la métaphysique des miroirs). Et là aussi, même question, connivence ou coïncidence ? L’avenir dira.
Les recherches présentées dans Procès et Miroir sont le résultat d’une réflexion soutenue sur la nature des processus dans l’univers, la matière, la vie. J’ai notamment dégagé une interprétation inédite de la métaphysique d’Aristote où la notion de matière prend un sens nouveau et plus actuel si on la rapproche de la notion de mouvement, voire carrément d’énergie. Du coup, un nouvel hylémorphisme est possible si on prend en considération la dualité forme et énergie, laquelle peut-être extraite à partir d’un développement de l’équation de Schrödinger. Mais en fait, tout est parti d’une tentative de formalisation des couplages cognitifs entre un système et son environnement. Une question, comment perçoit-on ? La science mécaniste répond par la métaphore d’une rétine qui est impressionnée telle une pellicule photo, alors que les informations sont transformées pour être communiquées au cerveau (thèse du couplage par input). Cette conception est naïve et c’est grâce aux travaux de Varela que les sciences cognitives ont pu sortir de leur sommeil dogmatique. La théorie de l’autopoïèse énonce que le système naturel construit ses représentations et donc, tout part du système-sujet (thèse du couplage par clôture). On voit bien les limites de l’une et l’autre des deux thèses. Une solution possible serait d’envisager un couplage dynamique par le processus que j’ai conçu et qui est défini par le concept de réduction et échange de paquet d’ondes. Un processus qui se situe à l’interface entre le système et l’environnement. Des informations entrent dans le système et ce même système envoie lui-même des informations. De ce « subtil mélange » résulte le couplage cognitif. Le concept est construit par analogie avec le mécanisme de réduction de paquet d’ondes en physique quantique, mécanisme se produisant lors de la mesure microphysique au cours de laquelle seul un état quantique est exprimé par la particule, si bien que l’observateur sait après l’expérience quel est l’état de son « objet quantique ».
Ceci nous amène aux trous noirs et à cette question de l’entropie qui disparaît quand le trou noir absorbe masse et rayonnement mais comme l’indique la gravitation quantique, cette information se retrouve à la surface intérieure du trou noir. D’où l’idée de mettre en correspondance cet objet quantique avec la conscience et surtout, le processus perceptif. Le monde entre dans le sujet et cette entropie absorbée se retrouve sous forme d’une information spatialisée qui n’est autre que le champ de vision. Et voilà un élément du puzzle manquant. Le concept de réduction échange de paquet d’onde prend une forme nouvelle. C’est un échange doublé d’une transformation des informations. Le monde perceptible est pourvu de figure, d’ordre. La perception se fait contre l’entropie du monde matériel, monde multiple selon Plotin, voué à la dispersion. L’idée doit être développée. En fin de compte, nous sommes tous, sujets et hologrammes. Ce qui rejoint par ailleurs ma théorie des systèmes vivant où interviennent des centres organisateurs possédant des informations sur le tout et la partie qu’ils assurent. Nous serions composés de trous noirs. Ou du moins, notre perception et notre conscience présentent une analogie avec la mécanique quantique du trou noir.
Bien évidemment, ces choses ont quelque peu troublé mon esprit en ce 21 juillet où je m’apprêtais à animer un café philosophique sur le connais-toi toi-même. Le soir, je repensais à ces histoires de surface du trou noir en écoutant Xenon codex de Hawkwind, musique des plus space pour accompagner une méditation scientifique tout aussi space. Mon rêve eut lieu la nuit de la sainte Marie-Madeleine. C’est plus chic que le rêve de la saint Martin de Descartes. Bref, je me voyais en trou noir dans ce rêve assez secouant, pénétré d’intuition sur le monde de surface voué à l’entropie et le monde intérieur, digérant le flux des matérialités pour recomposer les formes. J’étais ce trou noir assez étrange, autour duquel le monde tournait. Le flux du monde prenait la figure de l’entropie alors que la conscience se présentait à l’inverse comme un champ de vision parfaitement ordonné et même, préservé du chaos universel. Par quel stratagème la conscience produit-elle des perceptions ordonnées, domptant de ce fait l’entropie mondiale. Un trou noir serait-il pourvu d’un rayonnement cohérent pouvant projeter à sa surface les recompositions d’un hologramme encodé dans l’esprit ? Que de questions sur la nouvelle gnose à venir, en ce 21ème siècle. Une gnose élaborée par la pensée et le champ des formalismes scientifiques. Quant à la physique, elle risque de se transformer en méta-physique. Ces histoires de trous noirs, de principe holographique, d’entropie et de gravitation méritent un approfondissement. L’atome dont nous sommes constitués présente quelques connivences avec le trou noir théorisé dans le contexte de la gravitation quantique. L’enquête devrait porter sur cette possible super thermodynamique dont on ignore quelles surprises elle recèle. Sans doute les clés de la vie et de la conscience.
Nous voilà projetés dans un horizon gnostique où la science sera au service d’une gnose nouvelle destinée à expliquer le réel, comprendre la genèse du cosmos, de la vie, de la conscience. Nous ne sommes pas au bout des surprises. Cette science nouvelle pourrait être qualifiée de sacrée, complémentaire de la science profane projetée dans les rêves de la saint Martin effectués par Descartes. Mais nul ne peut dire quand ce projet aboutira car l’époque n’est plus en quête de gnose où alors si d’aucuns s’en réclament, c’est bien souvent pour exercer un pouvoir et manipuler les gens et servir ses propres intérêts. Un mot pour finir. Les éditeurs et les mécènes de passage ayant trouvé un intérêt à ces idées sont les bienvenus.
