DSK : La tentation du complot
par Bruno Fay
jeudi 19 mai 2011
De Ben Laden à DSK, en passant par Fukushima et l'affaire du Mediator, chaque nouvel événement génère désormais son flot de théories du complot. Décryptage.
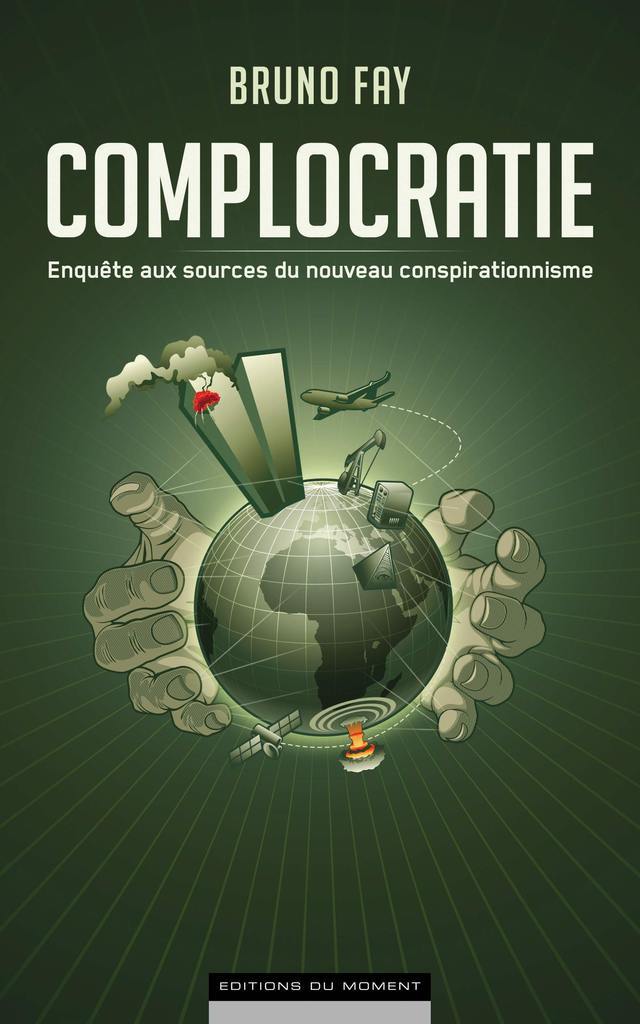

Une grande majorité de Français (57%) considère Dominique Strauss-Kahn "victime d'un complot", selon un sondage réalisé le 16 mai par CSA. Les réactions à l'arrestation de DSK sont la dernière illustration de la naissance de ce nouveau conspirationnisme que j'analyse longuement dans mon livre Complocratie, paru aux éditions du Moment. Un conspirationnisme ordinaire, de masse, qui touche désormais tous les catégories de la population. L'objet de cette tribune n'est pas de savoir si DSK est l'auteur ou non des faits qui lui sont reprochés – la justice apportera la réponse à cette question en temps et en heure et je me garderai bien de trancher dans un sens comme dans l'autre – mais de comprendre pourquoi la théorie du complot, avérée ou non, séduit autant de personnes.
Réduire les conspirationnistes à des marginaux, des illuminés ou des extrémistes constitue une erreur d’appréciation héritée d’un schéma de pensée dépassé. Non, 57% des Français ne sont ni fous ni antisémites. Une nouvelle forme de conspirationnisme est indéniablement en train de naître sous nos yeux. Un conspirationnisme ordinaire, éloigné de ce que nous connaissions jusque-là. Longtemps cantonnée à des groupuscules extrémistes qui s’échangeaient des livres sulfureux sous le manteau, la rhétorique conspirationniste a touché un public plus large, gagnant l’ensemble de la société. Si le mythe du grand complot juif ou franc-maçon persiste dans certains cercles, il est aujourd’hui noyé parmi des centaines de théories qui se fondent sur d’autres présupposés.
Dans Psychologie des foules, le sociologue Gustave Le Bon écrit : « En étudiant l’imagination des foules, nous avons vu qu’elles sont impressionnées surtout par des images. Si l’on ne dispose pas toujours de ces images, il est possible de les évoquer par l’emploi judicieux des mots et des formules. […] On élèverait une pyramide plus haute que celle du vieux Khéops avec les seuls ossements des victimes des mots et des formules. » Ces propos datent de 1895. La photographie en couleurs et la radio n’existaient pas encore. Que dirait aujourd’hui ce bon Gustave en découvrant la radio, la télévision, la téléphonie mobile et Internet ? La puissance des images, des mots et des formules a été surmultipliée. En suivant son raisonnement, ce n’est plus une pyramide que nous pourrions bâtir, c’est l’Everest. Dans la foule, les idées, les sentiments, les émotions, les croyances possèdent un pouvoir de transmission aussi puissant que celui des virus. À l’ère de la foule digitale, des textos et des réseaux sociaux, la pertinence de cette analyse n’en est que plus forte.
Les images de Dominique Strauss-Kahn menotté ont immédiatement fait le tour de la planète. Sa comparution devant la juge Melissa Jackson était commentée en temps réel sur Twitter. C'est également sur Twitter qu'ont été annoncées en premier la mort de Ben Laden et l'arrestation du Directeur du FMI. Nous ne pouvons faire l'impasse sur l'impact de la rapidité de diffusion des informations et de la mondialisation médiatique. Il fallait jusqu’alors un certain temps avant qu’un mythe ne se sédimente. Par le passé, l’imaginaire conspirationniste devait se fonder sur des faits d’actualité durables. Aujourd’hui, le bouche à oreille ne constituant plus l’unique support de ces récits, on voit émerger toutes sortes de mythes du complot concernant, par exemple, la réalité de la menace nucléaire au Japon, la mort de Ben Laden ou l'affaire DSK. Et nous tous, journalistes, ne prenons plus le temps d'analyser les événements, de prendre du recul. Du coup, nous ne faisons plus ce travail de vérité pourtant nécessaire pour démêler le vrai du faux. Nous ne prenons plus le temps de décortiquer suffisamment les événements, de les mettre en perspective. Face à cette défaillance des médias, les citoyens sont légitimement amenés à chercher leur propre vérité ou à chercher d'autres vérités.
Beaucoup de ressorts psychologiques peuvent être mis en avant pour expliquer comment on adhère à des croyances ou à des théories du complot, avérées ou non d'ailleurs. Le sentiment de puissance, bien sûr, nourri par l’impression d’accéder à une vérité cachée du commun des mortels. Le besoin de trouver des réponses simples à la complexité du monde, aux mystères de la science. Une forme de « raison paresseuse », pour reprendre l’analyse de Kant, nous épargnant de rechercher des causes qui nous échappent et d’y apporter des explications logiques à partir des seules connaissances acquises. Le refus de la fatalité et du hasard dans la marche du monde. Le besoin de réenchantement, parfois d’essence religieuse, pour comprendre notre environnement et donner du sens à l’absurde. Parfois aussi, la recherche d’un bouc émissaire. Enfin, une tendance naturelle à prêter aux événements extraordinaires des explications elles-aussi extraordinaires. C'est le cas des attentats du 11 septembre. Il en est de même avec les personnalités de premier plan. Elvis Presley, Lady Di ou Michaël Jackson ont chacun connu des destins extraordinaires. Leur mort ne peut donc être, elle aussi, qu'extraordinaire. Le même phénomène s'applique à Dominique Strauss-Kahn. De prime abord, son parcours flamboyant, sa brillante carrière et ses nobles ambitions ne nous paraissent pas compatibles avec les faits qui lui aujourd'hui reprochés. Mécaniquement, on se dit qu'il ne peut être que l'objet d'un mégacomplot, d'une diabolique conspiration planétaire à la hauteur de sa dimension politique et des attentes qu'il génère, ou qu'il générait, dans l'opinion publique française. Pour autant, toutes ces explications ne suffisent pas à expliquer pourquoi les citoyens sont de plus en plus nombreux à adhérer à des thèses conspirationnistes. D'autres facteurs entrent en jeu, dont le cas de Dominique Strauss-Kahn est symptomatique.
Mon livre Complocratie est le résultat d'un long travail d'enquête qui m'a permis de démontrer que le succès des théories du complot se nourrit avant tout des mensonges et des manipulations avérées de la société. L'hyperinformation dans laquelle nous vivons génère une société de l'hyperdésinformation. Il suffit d'évoquer le mensonge sur les armes de destruction massive en Irak, la photomontage publiée dans les premières heures de l'annonce la mort de Ben Laden ou le pseudo scandale d'espionnage au sein de l'entreprise Renault. Les autorités, qu'elles soient politiques ou économiques, profitent de plus en plus de cette défaillance des médias à aller au fond des sujets pour manipuler l'information. La guerre économique n'a jamais été aussi dure. Les coups tordus se multiplient et les citoyens croient de moins en moins à ce qu'ils entendent à la radio et à ce qu'ils lisent dans les journaux. Et, surtout, les vrais complots existent.
Pendant que Dominique Strauss-Kahn tourne en rond dans sa cellule de Rikers Island, des hommes de premier plan sont en ce moment même jugés devant la Cour d'appel de Paris dans le cadre de l'affaire Clearstream. Un vrai complot politique, pour le coup, même si les responsabilités ne sont toujours pas clairement établies. Comment ne pas faire le parallèle ? Ce type de coups tordus donnent des raisons objectives aux Français d'imaginer que Dominique Strauss-Kahn ait pu être à son tour victime d'un complot politique. La théorie du complot autour de l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn n'est pas un cas isolé. Elle est révélatrice d'une crise de confiance bien plus profonde entre les citoyens et les autorités. Nous sommes entrés dans l'ère du doute permanent. Bienvenue en Complocratie !
Bruno Fay
