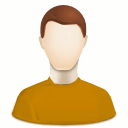Tableau de bord
| Rédaction | Depuis | Articles publiés | Commentaires postés | Commentaires reçus |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 0 | 1228 | 0 | |
| 1 mois | 0 | 18 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 2 | 0 |
Derniers commentaires
-
JEANNE LA PAPESSE
De tous les faits transmis par l’histoire de l’Église, il en est peu qui ont frappé l’imagination publique et occupé les controverses comme la question de savoir si, au IXème siècle, une femme avait occupé le trône pontifical sous le nom de Jean VIII.
Il est naturel que l’esprit clérical, qui s’est affirmé dans la haine et le mépris de la Femme à travers les siècles, soit arrivé à nier le fait comme une honte pour l’institution même de la papauté. Mais il est certain que les historiens du temps et des siècles rapprochés de cette époque l’ont affirmé de façon qui ne permet pas d’en douter.
Il est bien certain qu’une légende se forma autour de ce fait aussitôt qu’il fut connu. Voici le fond de l’histoire, dégagée de ce qui y fut ajouté par l’imagination des hommes :
Cette femme extraordinaire était née à Fulda (Hesse), d’une excellente et riche famille, et se nommait Jutta. Restée orpheline fort jeune et placée par ses tuteurs dans un couvent, son éducation y fut très soignée, car, dès son enfance, elle parlait couramment plusieurs langues étrangères. Elle venait d’atteindre sa seizième année, quand le confesseur du couvent, un jeune moine d’origine anglaise, devint follement amoureux d’elle. Il ne tarda pas à voir sa passion partagée et à en recevoir les preuves les plus positives.
Comme, à cette époque, il ne fallait pas plaisanter avec les vœux monastiques, les amants n’avaient d’autre ressource que la fuite ; pour plus de sécurité, Jutta endossa les habits masculins.
Grande et mince, un peu osseuse, point jolie, mais des traits accentués et énergiques, avec plus d’intelligence que de charme, elle n’éveilla, sous son nouveau costume, aucun soupçon. Les amants arrivèrent sans encombre à Athènes, se faisant passer pour deux frères venus d’Angleterre afin d’étudier en cette ville, et c’est ainsi que la jeune fille ne fut plus connue que sous le nom de Jean l’Anglais.
Ils vécurent heureux et tranquilles pendant plusieurs années sans que leur secret fût connu. Jutta, douée des plus hautes facultés intellectuelles, étudiait passionnément la philosophie, l’histoire, les lettres. Un événement imprévu, en brisant son cœur, décida de sa destinée : son amant mourut.
Folle de désespoir, et résolue à rester fidèle à sa mémoire, elle se jeta dans l’étude de la théologie, se fit ordonner prêtre et quitta Athènes pour aller se fixer à Rome, où son vaste savoir attira bientôt l’attention, et, toujours sous le nom de Jean l’Anglais, elle devint prêtre de paroisse.
Elle vécut ainsi pendant quelques années dans la pratique de toutes les vertus. Les talents, l’éloquence du prêtre Jean prirent une renommée telle que, à la mort de Léon IV, tous les suffrages se portèrent spontanément sur ce saint personnage comme seul digne de remplacer le pape défunt.
Les attributions de la papauté n’étaient pas encore alors ce qu’elles sont devenues depuis, puisque, même deux siècles plus tard, dans un synode tenu en 1076, Grégoire VIII, qui fut cependant un des plus remarquables pontifes romains, n’occupait encore que les fonctions d’évêque de Rome.
Dans les premiers siècles de l’Église, les évêques étaient nommés par l’acclamation du peuple assemblé. On choisissait ordinairement le pasteur de l’église la plus importante ou le plus renommé pour ses talents ou ses vertus. Cette élection faite par le suffrage des fidèles était confirmée par le clergé et les autres évêques de la province, qui imposaient les mains au nouvel élu ; toute la cérémonie de l’investiture se résumait en cette simple formalité.
Comment mourut-elle ? C’est ce que l’histoire a cherché à nous cacher ; mais nous considérons comme vraisemblable que c’est pendant la conspiration dirigée contre elle par la faction de Formose, qu’elle fut attaquée et mourut d’un coup de marteau sur la tête. C’est après sa mort qu’on constata son sexe, et alors le grand étonnement qui résulta de cette découverte exalta l’imagination des hommes, qui lui créèrent immédiatement des légendes.
Il est dans la nature de l’homme d’attaquer bassement toute femme qui s’élève et se distingue ; on attaqua celle-là après sa mort, son sexe n’ayant pas été découvert avant, et voici la légende ridicule que l’on plaça à la fin de sa vie :
Un jour, pendant une procession, non loin du Colisée, on vit le Saint Pontife donner des signes non équivoques de malaise et bientôt se tordre dans un accès de violente souffrance ; le Saint-Sacrement échappa de ses mains défaillantes, et le Pontife expira en mettant au monde un enfant du sexe féminin.
Malheureusement pour ces chroniqueurs fantaisistes, le Saint-Sacrement ne fut inventé que beaucoup plus tard, en 1264 (à peu près), par le pape Urbain IV.
Suite -
La Sorcière, sublime Prêtresse qui chantait le cantique de la Nature, l’inspiratrice des hommes, la grande consolatrice, Celle qui était la promesse et la miséricorde, Celle qui était la science et guérissait toutes les blessures, a été chassée du temple. L’ignorance a pris sa place et s’est faite orthodoxie. Alors, que va-t-elle devenir ? Qu’elle le veuille ou non, la voilà destinée à l’œuvre sourde des conspirations et au massacre.
Après ce massacre de la Femme, qu’allait-il rester de la société humaine ?
Il restait la Nature avec ses éternelles lois. Il restait la Femme… Déesse sans autels, Reine sans royaume, qui n’ose avouer sa royauté,… mais la prend quand même ! Mais toutes n’étaient pas des femmes fortes, des sorcières. Il y avait aussi les femmes faibles et amoureuses de l’homme perverti. Celles-là vont au prêtre, et ce sont les riches, les joyeuses, les heureuses, celles qui plaisent aux séducteurs par leurs complaisances.
Mais les femmes fortes allaient à l’homme maudit, à celui que, par un paradoxe fréquent, le prêtre appelait « Satan », c’est-à-dire à l’homme vrai, grand et droit. Elles allaient donc au diable, elles se donnaient au diable, modeste, pauvre, déshérité comme elles. Ce sont eux qu’on appelle les bons hommes, on les prend en pitié parce qu’ils n’ont pas l’astuce et l’hypocrisie des grands seigneurs de l’Église. Ces naïfs sont restés fidèles à l’antique loi morale ; aussi, comme ils sont ridiculisés, avilis, meurtris, les pauvres grands bons hommes, et hués par le peuple abruti ! Mais qu’importe à ces hommes ce qu’on dit d’eux ? il leur reste la vraie femme, la grande, c’est-à-dire tout, et c’est cela qui, finalement, les fera triompher.
Lien -
La connaissance ne peut être acquise que par une compréhension personnelle que l’homme doit trouver seulement en lui-même : « Connais-toi toi-même », disait l’expression inscrite sur le fronton du temple de Delphes ; maxime dont une des variantes modernes se retrouve dans l’investigation du « ko ’ham » ou « Qui suis-je ? » védantique de Ramana Maharshi ou dans le fameux hadîth de la tradition islamique : « Man arafa nafsahu faqad arafa Rabbahu » (« Celui qui se connaît soi-même connaît son Seigneur »).
Aucun enseignement « conventionnel » n’est capable de donner la connaissance réelle. Sans cette compréhension, dit René Guénon, aucun enseignement ne peut aboutir à un résultat efficace. Et l’enseignement qui n’éveille pas chez celui qui le reçoit une résonance personnelle ne peut procurer aucune sorte de connaissance (« Être ce que l’on connaît ») ; toute vraie connaissance est un ressouvenir. C’est pourquoi Platon dit que « tout ce que l’homme apprend est déjà en lui » et qu’Ibn Sina (Avicenne) exprime ainsi : « Tu te crois un néant et c’est en toi que réside le monde. ».
Toutes les expériences, toutes les choses extérieures qui l’entourent ne sont pour l’homme qu’une occasion pour l’aider à prendre conscience de ce qu’il a en lui-même. Cet éveil est ce que Platon appelle « anamnésis », ce qui signifie « réminiscence ». Si cela est vrai pour toute connaissance, ce l’est d’autant plus pour une connaissance plus élevée et plus profonde, et quand l’homme avance vers cette connaissance, tous les moyens extérieurs et sensibles deviennent de plus en plus insuffisants jusqu’à perdre finalement toute utilité. S’ils peuvent aider à approcher la sagesse à quelque degré, ils sont impuissants à l’acquérir réellement, quoiqu’une aide extérieure puisse être utile au début, pour préparer l’homme à trouver en lui et par lui-même ce qu’il ne peut trouver ailleurs et particulièrement ce qui est au-dessus du niveau de la connaissance rationnelle. Il faut, pour y atteindre, réaliser certains états qui vont toujours plus profondément dans l’être, vers le Centre qui est symbolisé par le Cœur et où la conscience de l’homme doit être transférée pour le rendre capable d’arriver à la connaissance réelle. « Ainsi, dit Ibn Arabî, il n’y a de Connaissance de la Vérité Suprême provenant de la Vérité même que par le Cœur ; ensuite cette connaissance est reçue par l’Intellect, de la part du Cœur. »
Ces états qui étaient réalisés dans les Mystères antiques étaient des degrés dans la voie de cette transposition du mental au Cœur.
Ceux qui se font initier, assure Aristote, apprennent moins quelque chose, qu’ils ne font l’expérience de certaines émotions et ne sont plongés dans un état d’esprit particulier ; « Ne pas apprendre mais éprouver », dit-il à propos des Mystères d’Eleusis ; « Non pas apprendre mais subir la vérité », disent également les moines orthodoxes à propos de l’acquisition des états conduisant à la Réalisation spirituelle.
C’est ainsi que le Pèlerinage est une figure de l’Initiation, de sorte que le « Pèlerinage en Terre Sainte » est, au sens ésotérique, la même chose que la « Recherche de la Parole perdue » ou la « Queste du Saint Graal » ; expressions qui se rattachent à un symbolisme que l’on retrouve dans presque toutes les traditions, et qui font allusion à quelque chose qui, à partir d’une certaine époque, aurait été perdu ou tout au moins caché, et que l’Initiation doit faire retrouver.
Julius Evola définit l’Initiation comme une réalisation de la Connaissance au moyen d’une sorte de dessillement, tout comme si, à la suite d’une opération chirurgicale, « l’Œil aveugle », que l’on peut identifier avec l’« Œil de la Connaissance » ou « troisième Œil » de la tradition hindoue, voire aussi l’« Œil du Cœur » (aynul-qalb) de l’ésotérisme islamique, c’est-à-dire « l’Œil de l’Âme » se rouvrait et se mettait à voir.
« Tu souriras alors, en connaissant si simples, les notions qui te paraissaient si abstruses lorsque tu n’étais qu’un profane, et tu avoueras qu’il n’était pas d’explication possible, avant l’investigation personnelle, destinée à préparer ton esprit à recevoir les semences du vrai. » (E.J. Grillot de Givry, Le Grand Œuvre) Et c’est dans ce sens qu’il est dit que nul ne peut être initié que par soi-même ; « Aide-toi, le ciel t’aidera » nous dit la sagesse populaire.
C’est pourquoi la Vérité ultime n’est pas quelque chose qui reste à découvrir, mais quelque chose qui reste à être compris par chacun, et chacun doit faire le travail pour lui-même.
« Tu ne me chercherais pas si tu ne m’avais pas trouvé » dit le Christ aux Paiens ; « Je trouve et ensuite je cherche pourquoi j’ai trouvé » dit Jean Cocteau, à propos de la Gnose (la connaissance première).
Le discernement du Cœur (apprendre « par le Cœur » et non « par cœur ») permet de séparer la paille et le grain, l’esprit de la lettre. C’est cette faculté de l’âme qui donne le sens des « causes premières ».
NB : La Solitude ou le goût irrésistible de la Liberté
Dans « Les Sept Tours du Diable », Jean-Marc Allemand rappelle que René Guénon signa certains de ses écrits de ses initiales A.W.Y. soit respectivement les trois lettres arabes « Alif », « Wâw », « Yâ’ ». La lettre « Alif » a pour valeur 1, le nombre de l’Unité. « Sache, dit le Cheikh Ibn ’Atâ’ Allah al-Iskandarî (dans son Traité sur le nom d’Allah), que celui à qui est dévoilée la connaissance du secret du Alif et qui se réalise par lui, a été gratifié de la connaissance du secret de la réalisation de l’Unicité ; il accède ainsi à la station de la connaissance du secret de la solitude (Wahda) de l’Unité ».
N’oublions pas, rappelle encore J.-M. Allemand, que la réalisation initiatique de René Guénon est celle des Afrâd (les solitaires).
« L’homme de l’initiation doit s’arracher du monde, obstacle à la réflexion qui empêche la spéculation de l’absolu en lui », écrit Solange Sudarskis (« La Solitude du nombre 1 »).
« Seuls les solitaires ont accès au Royaume », disait Guillaume de St Thierry au XIIe siècle.
Cet enseignement peut être retrouvé dans les textes et catégories de pensée qui évoquent le thème du « désert » et de la « quête », thème qui apparaît dans la plupart des religions et traditions initiantes.
Ce que l’on peut retenir dans ces hiéro-histoires, c’est que le désert permet un temps sacro-saint, où s’accomplit l’expérience religieuse ou mystique, où s’abolit la différence du saint et du sacré. C’est un mouvement par lequel l’homme en se recueillant au « désert », s’élève à la transcendance (souvent appelée Dieu ou le divin). Dans sa quête, le désert est l’épreuve et le lieu du combat contre le principe du Mal. En ce sens c’est un lieu de passage : se quitter soi-même, abandonner son moi superficiel pour trouver son Soi. Il est comme un centre de labyrinthe où se vivra aussi l’expérience fécondante de la solitude et des combats. Mais cette solitude, cet esseulement n’est jamais le lieu où doit se fixer définitivement l’initié.
Le désert, lieu où la quête ne s’y achève pas, conduit à une deuxième naissance, celle de toutes les « terres promises ».La Solitude s’avère le contraire de l’égocentrisme, du repliement sur soi et de la revendication pour sa petite personne. Le véritable Solitaire se passe de témoins, de courtisans et de disciples. Le Solitaire sait qu’il a beaucoup à apprendre alors que la plupart ne cherchent qu’à enseigner, à avoir des disciples. Il lit, écoute, réfléchit, mûrit ses pensées comme ses sentiments. En cet état, il pèse le moins possible sur autrui : il ne cherche pas, au moindre désagrément, une oreille où déverser ses plaintes, il ne rend pas l’autre responsable de ses faiblesses et de ses incompétences, il ne peut exercer sur personne un chantage affectif.
La solitude, comme l’humilité, est bien une école de respect de l’autre et de maitrise de soi.
Blog -
Selon Philip K. Dick, ce sont les gens simples qui s’opposeront au pouvoir fou : « Les gens ne peuvent pas vivre de cette manière, ébranlés par les puissances politiques et économiques. Un jour il y aura la résistance. Une résistance forte et désespérée. Et pas des hommes forts et puissants mais des petites gens, des chauffeurs de bus, des épiciers, des laveurs de vitres, des serveurs, … »
Rappelons néanmoins ceci : Par les révoltes et les massacres on n’arrive jamais à quoi que ce soit. Très peu de temps après, c’est encore pire. Après chaque révolution, ce sont les mêmes désordres, les mêmes malhonnêtetés, les mêmes gaspillages, les mêmes injustices… Les victimes et les bourreaux ont changé de camp, mais il y a toujours des victimes et des bourreaux. Alors où est le progrès ?
Ce ne sont pas les transformations extérieures qui produiront les véritables améliorations. C’est la mentalité humaine qu’on doit changer, c’est là, surtout, qu’il faut faire la révolution.
NB : Dans le Livre de Tobie, L’Ange incognito qui va servir de guide, de « Compagnon de route », à Tobie dit qu’il se nomme Azarias ; ce nom formé sur le terme hébreu « ezer », qui signifie « aide », est aussi employé dans la Genèse pour désigner la femme que le créateur donne comme « aide » à Adam. C’est le secours prodigieux que Dieu propose à l’homme seul ou en détresse afin de le relever.
Le vilain crapaud ne devient-il pas le beau prince lorsque la princesse l’embras(s)e ?
Embras(s)ement ! -
« Gaza : comment peut-on tirer sur des gens affamés ? »
D’où vient, d’une manière générale, se manque de sensibilité chez certains individus ?
Explication : Si nous suivons l’évolution sexuelle de l’homme depuis l’enfance, nous voyons que c’est dans la période qui précède l’adolescence que l’esprit prend son plus grand développement ; la multitude d’idées que l’enfant acquiert, en quelques années, demande un travail cérébral qui dépasse de beaucoup l’effort que l’homme adulte pourrait faire.
Quel est celui qui ne se souvient d’avoir traversé, dans son enfance, cette période de grande lucidité, pendant laquelle il observait la Nature, il cherchait la cause des phénomènes qui se produisaient autour de lui et essayait de résoudre les grands problèmes de la philosophie naturelle ?
Quelle est la mère qui n’a constaté, chez son enfant, cette grande curiosité de la Nature qui se révèle par d’incessant pourquoi ?
Suivons-le et voyons-le arriver à l’âge ingrat de la première jeunesse. Ce n’est plus la Nature qui va le préoccuper, c’est la femme. Ses facultés intellectuelles sont amoindries, mais ses sens sont développés ; il a perdu le jugement droit de l’enfant, mais il va le remplacer par l’imagination ; en même temps il acquiert une audace qui lui tient lieu de logique.
Les suites fatales de la sexualité masculine, c’est-à-dire les conséquences de l’union des sexes, font apparaître en lui les germes des 7 faiblesses humaines dont la Théogonie fit les 7 péchés capitaux :
- L’orgueil qui va lui insinuer des idées de supériorité vaine.
- L’égoïsme qui lui conseillera de prendre aux autres ce qu’ils ont, leur avoir, leurs places dans la vie, leurs privilèges et les honneurs qui leur sont dus.
- L’envie qui va lui souffler ses premières haines.
- La colère qui le jettera dans des disputes, des violences et des crimes.
- La luxure qui fera apparaître en lui la bête humaine.
- L’intempérance qui altérera sa santé et troublera sa raison.
- La paresse qui l’amollira et fera de lui un être inutile, à charge aux autres.
Ajoutons à cela l’invasion du doute, père du mensonge, du mensonge, père de l’hypocrisie génératrice de la ruse.
Son esprit a des éclipses, des moments de torpeur. Chacune de ses « œuvres basses » lui fait perdre une parcelle de l’étincelle de vie ; c’est une brèche par laquelle entre peu à peu la déraison, si vite envahissante. C’est alors qu’il commence à renverser l’ordre des idées, que son jugement perd sa droiture, qu’il se fausse. Des intérêts personnels, des entraînements sexuels commencent à le guider. C’est l’âge de la perversion qui apparaît. Puis sa force musculaire qui augmente lui donne de l’audace et sa sensibilité qui s’atténue le rend dur et méchant, il ne sent plus autant la souffrance des autres.
« L’homme est un loup pour ses semblables », a dit Hobbes. C’est que la haine naît en lui dès son entrée dans la vie sexuelle. Le petit garçon commence à détester la vie dans les autres en attendant que l’homme déteste les hommes. Faire souffrir ses petits camarades, ses petites sœurs, les vexer, les narguer, les taquiner est déjà un plaisir pour lui. Cette haine de la vie se manifeste aussi envers les animaux, envers les insectes qu’il torture pour le plaisir de les torturer. On dirait qu’il veut se venger sur l’univers tout entier des conditions physiologiques et psychiques qui s’imposent à lui. Le jeune adolescent prend en haine le genre humain, qu’il considère comme un témoin de sa déchéance. Il cherche la solitude parce qu’il lui semble que, parmi les autres, il va se trouver humilié. La misogynie naît aussi en lui, à ce moment, et la première femme sur laquelle tombe sa haine de sexe, c’est souvent sa mère ; il ne veut plus l’embrasser, il la craint et la fuit.
LIEN
Agoravox utilise les technologies du logiciel libre : SPIP, Apache, Ubuntu, PHP, MySQL, CKEditor.
Site hébergé par la Fondation Agoravox
A propos / Contact / Mentions légales / Cookies et données personnelles / Charte de modération